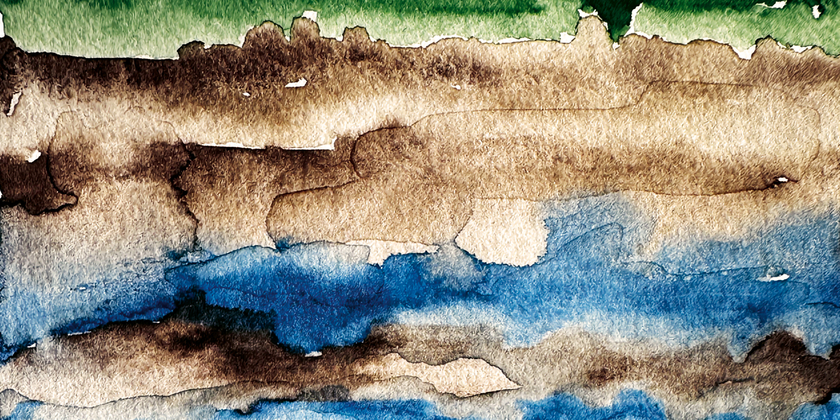InfEau Magazine 2025: Eaux souterraines: utilisation et protection de la ressource en eau potable
En Suisse, 80 pour cent de l’eau potable provient des eaux souterraines. Dans la région très peuplée du Plateau en particulier, la protection de cette ressource est de plus en plus difficile.
Des polluants émergents ou nouvellement découverts, comme les PFAS, posent de nouveaux défis.
Le réchauffement des eaux et l’allongement des périodes de sécheresse liés au changement climatique aggravent la situation.
Dans ces circonstances, les distributeurs d’eau potable peuvent-ils continuer de livrer une eau souterraine quasiment non traitée? Pourquoi certains problèmes identifiés depuis longtemps, comme la pollution par les nitrates, ne sont-ils toujours pas vraiment résolus? L’édition 2025 de la journée d’infEau de l’Eawag, le 4 septembre, était dédiée à ce genre de questions. Les scientifiques de l’Eawag y ont présenté les résultats de leurs recherches et proposé des outils pour aider les responsables et les autorités à protéger la ressource en eau potable, d’un point de vue tant quantitatif que qualitatif. Nous vous présentons les principaux points dans les articles suivants.
En point de mire
 | «Nous devons préserver notre ressource en eau potable» |
 | Améliorer la mise en œuvre des prescriptions légales La loi exige que les captages d’eau potable soient protégés des pollutions et contaminations par des zones de protection des eaux souterraines. Des déficits d’exécution et des conflits d’utilisation l’empêchent toutefois souvent. Le Parlement a donc décidé d’une adaptation de la loi et d’autres mesures pour garantir que, même à l’avenir, les eaux souterraines puissent continuer de servir d’eau potable sans traitement notable. |
 | Moins d’eau en été, plus en hiver |
 | Une spécialiste de la traque des polluants |
 | Quand l’IA débusque les zones critiques pour les nitrates |
 | Protéger la biodiversité du sous-sol Les nappes souterraines abritent une diversité insoupçonnée d’invertébrés. Ils se nourrissent de microbes et contribuent ainsi à rendre l’eau souterraine utilisable pour la boisson. Dans les régions d’agriculture intensive, cette biodiversité est amoindrie. Les scientifiques plaident pour une surveillance systématique et l’établissement de listes rouges. |
 | «Nous voulons donner un visage aux eaux souterraines» Le Réseau suisse des eaux souterraines (CH-GNet) vise à favoriser la création de savoirs, à accompagner les projets spécialisés et à faciliter les échanges entre recherche et terrain. L’hydrogéologue Mario Schirmer a participé à sa fondation et fait partie de son équipe de direction. La collaboration entre recherche, administration et population lui tient particulièrement à cœur. |
 | Soutien à la mise en œuvre La plateforme Protection des eaux souterraines soutient les services cantonaux, les communes, les distributeurs et les bureaux privés dans l’exécution des nouvelles tâches qui leur incombent en matière de protection des eaux souterraines. L’objectif: sécuriser l’avenir de l’approvisionnement en eau potable, d’un point de vue tant quantitatif que qualitatif. Elle développe pour cela de nouvelles ressources techniques et méthodologiques pour la pratique et favorise les échanges de savoirs. |
 | Comment la nappe phréatique réagit au stockage thermique Pour assurer un chauffage plus durable et moins carboné du campus de l’Empa et de l’Eawag, un nouvel accumulateur à sondes geothermiques haute température a été mis en place à Dübendorf. Un projet de recherche examine actuellement son impact sur la nappe phréatique. |
 | Milieu urbain: des îlots de chaleur même dans le sous-sol La température des eaux souterraines est souvent beaucoup plus élevée en ville qu’à la campagne. Des études menées à Bâle montrent que la chaleur résiduelle des constructions souterraines est la principale responsable de ce réchauffement. Une modélisation en 3D du transport de chaleur permet de calculer les apports d’énergie calorique dans la nappe souterraine. La chaleur ainsi accumulée dans le sous-sol pourrait être utilisée à des fins de chauffage. Il y a là un vrai potentiel. |
En couverture: grafikvonfrauschubert, Eawag